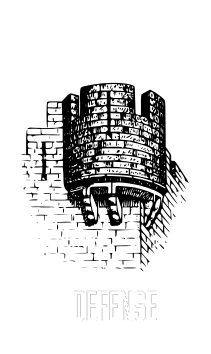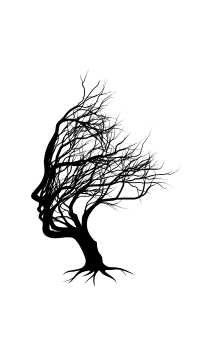Il arrive parfois qu’un enfant façonne un ami imaginaire qui l’accompagne au quotidien, à qui il parle, dans ses pensées ou à haute voix. Cet ami imaginaire sera nommé, il aura sa propre histoire, il deviendra le confident de l’enfant, qui lui racontera tous ses secrets, ses ressentis, ses affects. Dans un article consacré à ce sujet dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse (tome 13, 1978), R. M. Benson et D. B. Pryor rapportent le cas d’une petite fille de quatre ans parlant couramment à des animaux anthropomorphes. Elle les nomme, leur prépare des sacs pour ses sorties, réclame qu’on leur mette des couverts à table. Un autre cas, celui d’un garçon de sept ans qui parle couramment avec un extraterrestre venu d’une planète lointaine, est également présenté en détail. Ces amis imaginaires ont des fonctions proches de l’objet transitionnel théorisé par Winnicott. Ils servent de point d’appui, dans une relation anaclitique, et aident les enfants à grandir tout en colmatant des blessures narcissiques, comme la perte d’un parent ou un divorce. Nagera, en 1969 explique que le compagnon imaginaire « joue souvent un rôle positif spécifique dans le développement de l’enfant. Ce qui est important, ce n’est pas le contenu du fantasme associé au compagnon imaginaire, mais la finalité qu’il est censé avoir quant au développement« . Parfois le compagnon imaginaire sert de bouc émissaire, d’exutoire aux pulsions destructrices et agressives de l’enfant.
On aurait tort de vouloir priver l’enfant de ses amis imaginaire, compte tenu de leur rôle d’appui dans le développement affectif. Ainsi dans le cas du petit garçon et de son ami extraterrestre, un psychiatre pour adulte y vit un signe de schizophrénie avec délire paranoïde et fit interner l’enfant dans un service de psychiatrie pour adulte dans un hôpital militaire. Grave erreur : l’enfant n’était pas psychotique, il souffrait juste de l’absence de sa mère, décédée alors qu’il était bébé, et d’un père qui privilégiait sa carrière militaire au bien-être de son enfant, condamné à voyager tout le temps au gré des affectations de son père, ne pouvant donc jamais nouer des liens d’amitié durable avec ses pairs. À travers un compagnon imaginaire, l’enfant revendique ce qui est son droit : l’attention, l’amour, la compagnie. Dans l’immense majorité des cas, ce compagnon imaginaire disparaît avec l’âge, comme s’il devenait naturellement obsolète, l’enfant trouvant d’autres manières de pallier sa solitude (amis réels, créativité, symptômes…etc.).
Notons dans ce contexte la définition que Heinz Kohut donne du narcissisme : « Selon moi, le narcissisme ne se définit pas par le lieu de l’investissement instinctuel (que ce lieu soit le sujet lui-même ou un objet) mais par la nature de la charge instinctuelle elle-même. Le petit enfant, par exemple, investit les autres de libido narcissique et les perçoit selon le mode narcissique, c’est-à-dire comme des soi-objets. Le contrôle qu’il semble alors possible d’exercer sur ces objets (perçus comme soi-objets) se rapproche davantage du contrôle qu’un adulte s’attend à exercer sur son propre corps et son esprit que de celui que cet adulte se croit capable d’exercer sur les autres. » C’est ainsi, comme un soi-objet, que l’on peut considérer l’ami imaginaire. À l’adolescence, des amis réels seront substitués à l’ami imaginaire qui s’évaporera comme un vieux fantasme désormais révolu. Donc si votre enfant parle à un extraterrestre, pas de panique, il n’est ni schizophrène (pathologie qui démarre à la fin de l’adolescence), ni psychotique (il ne délire pas vraiment). Par contre, il est fort possible qu’il se sente seul et qu’il ait besoin de davantage d’écoute et d’attention. Une psychothérapie pourra être envisagée avec un psychanalyste travaillant avec des enfants.
Référence bibliographique :
« Quand les amis se volatilisent, à propos de la fonction du compagnon imaginaire » – R. M. Benson & D. B. Pryor in Nouvelle Revue de Psychanalyse, tome 13, Le narcissisme, 1978, pages 237 à 252.