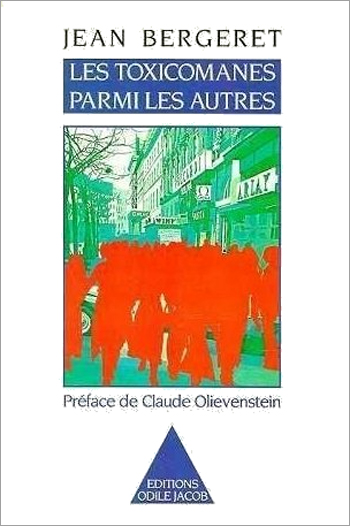Jean Bergeret est psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique à l’université Lyon 2. Il nous propose dans cet ouvrage de déconstruire la notion de toxicomanie. Il critique ainsi les deux versants des politiques de lutte contre les toxicomanies : la répression et le soin, qui si elles sont indispensables, ne résolvent pas pour autant les causes profondes des addictions, qu’il faut aller chercher du côté de la subjectivité des personnes toxicomanes. Ainsi une politique agissant sur l’offre des drogues uniquement, ne fonctionne pas, il nous faudrait plutôt agir sur la demande, en amont de la toxicomanie, notamment par la mise en place de politiques de prévention dès l’école primaire. Publié en 1990, l’ouvrage reste, malheureusement, d’actualité, le terme « addiction » étant venu remplacer celui de « toxicomanie », plus restreint (la pharmacodépendance). Agir sur la demande, c’est prendre en considération les situations de souffrance psychique dès le plus jeune âge afin d’éviter que ne se développe le recours aux drogues.
Voici quelques extraits choisis de cet ouvrage :
Page 26 :
Nous n’avons aucune envie de constater que nous possédons tous en nous un reste d’illusion infantile attendant une satisfaction, ou simplement un remède à nos déceptions qui proviendrait d’une action magique et extérieure ; autrement dit qu’une partie de nous-même fonctionne, plus discrètement certes, de manière contrôlée ou refoulée, mais exactement comme le besoin que le toxicomane affirme, au grand jour, dans son comportement. Le réveil inopportun de ce désir caché en nous est considéré comme inacceptable.
Page 45 :
Nous pouvons en effet constater cliniquement que la situation de dépendance profonde d’un sujet demeure avant tout d’ordre affectif. Nous ne pouvons, en conséquence, du point de vue thérapeutique, ni nous contenter d’un simple sevrage à l’égard du produit toxique sans nous occuper du besoin de dépendance affective sous-jacent, ni nous contenter non plus de remplacer une pharmacodépendance par une dépendance nouvelle, une dépendance affective entretenue et même encouragée, organisée, à l’égard d’une institution soignante.
Page 67 :
Il revient également aux pouvoirs publics l’obligation de dire la vérité sur ce que les spécialistes ont mis en évidence depuis longtemps, à savoir l’insuffisance d’une action centrée uniquement sur l’offre de produits toxiques. On sait en effet que la répression, pas plus que les soins donnés à ceux qui sont déjà toxicomanes, ne peut réduire d’une façon sensible le nombre des jeunes qui deviendront toxicomanes dans les années à venir. On ne saurait donc se contenter d’une action portant sur l’offre. Les pouvoirs publics savent et doivent faire connaître à l’opinion qu’il existe des moyens d’agir sur la demande, donc d’éviter que le nombre des toxicomanes augmente. Il est possible d’obtenir d’abord une stabilisation puis une diminution progressive du nombre des nouveaux pharmacodépendants. Il existe des mesures visant à la prévention au sens vraiment authentique du terme; il s’agit donc d’une prévention primaire et globale s’intéressant à la totalité de la personnalité du sujet, à son évolution affective.
Page 68 :
Nous constatons en effet que l’environnement naturel du futur toxicomane a souvent entretenu très tôt et de façon constante l’illusion que les problèmes quotidiens, petits ou grands, pouvaient être réglés grâce à des apports « magiques » et «extérieurs ». Par la suite un adolescent, déçu par les démentis progressifs qu’il reçoit au contact des réalités, se verra tout naturellement enclin à rechercher des gens ou des objets qui lui promettront une aide justement « magique » et essentiellement « extérieure ». À l’heure actuelle la drogue est dotée de ce prétendu pouvoir, non seulement quand elle est proposée par un camarade ou un dealer, mais dans la façon aussi dont la rumeur publique, la soi-disant «information» et le discours des médias apportent « sur un plateau » (même s’il s’agit d’une forme de propagande en apparence négative) l’assurance qu’il s’agit bien d’une source puissante d’effets « extérieurs » et « magiques».
Page 148 :
Le toxicomane représente donc un cas particulier, parmi d’autres situations très semblables, de carence du fonctionnement imaginaire. L’idée pessimiste que le toxicomane se fait de lui-même et l’importance accordée aux effets de l’entourage sur l’intérieur du sujet, conduisent à une demande de rétablissement artificiel de la satisfaction des désirs ; c’est là le seul moyen qui est envisagé pour satisfaire le besoin et éviter ainsi une sensation insupportable qu’on appelle le « manque » ; le manque essentiel résulte en fait d’une carence imaginaire de satisfaction, remontant à l’enfance.
Page 170 :
La représentation que l’on se fait du toxicomane n’est pas sans conséquence sur la façon dont nous entretenons les mythes autour de «la toxicomanie ». Cette représentation prend davantage en compte les détériorations subies à des registres divers, après un usage plus ou moins prolongé d’un toxique, que les points faibles de la personnalité propre du sujet, existant avant son contact avec le produit. Or les points faibles initiaux représentent les principaux facteurs de risques qu’il serait nécessaire de reconnaître à temps, au cours de l’enfance ou de l’adolescence, pour éviter au sujet de sombrer dans une pharmacodépendance tout autant que dans des difficultés, prenant des formes différentes, mais très parallèles, dans leur origine comme par leur gravité, pour l’avenir du comportement personnel et social des sujets menacés.
On le voit, pour Jean Bergeret, on ne peut pas concevoir la toxicomanie, sans s’intéresser à l’histoire personnelle, à la situation sociale, à la subjectivité de l’addict. Bien sûr, la répression des trafics et les soins sont indispensables, mais ces deux axes politiques ne suffisent pas. La répression est une solution de court terme, d’autant plus prisée qu’elle s’inscrit bien dans une politique du chiffre qu’aiment les politiciens. Le soin, lui, intervient lorsqu’il est déjà trop tard. Il peut empêcher les rechutes, mais pas résoudre à la racine le recours initial aux drogues. Par conséquent, il ne reste plus qu’à agir sur l’école et les familles, donc envisager le problème des drogues dans un long-terme qui implique que ceux qui initient ces politiques n’en verront pas les fruits avant dix ou quinze ans. Or depuis la parution de cet ouvrage de Jean Bergeret, force est de constater que ses prédictions et ses constatations restent toujours valides.
Ainsi il conclut page 233 :
Les toxicomanes cela existe, malheureusement; mais seulement à partir du moment où, chez le sujet, la demande, fondée sur un besoin de l’apport d’éléments magiques et extérieurs destinés à combler un vide affectif, parvient à engendrer le manque. En revanche la toxicomanie, cela n’existe pas en soi, on ne peut considérer comme réelle une abstraction englobant arbitrairement toutes les formes d’utilisation de produits toxiques et laissant en même temps de côté d’autres comportements graves de conséquences ayant les mêmes causes, en ne tenant aucun compte des prédispositions repérables avant le contact avec la drogue; l’emploi d’une dénomination illusoire nous entraîne à beaucoup d’erreurs et à beaucoup de déceptions.
Et page 237 :
En matière de prévention des pharmacodépendances et des troubles qui demeurent du même ordre, il conviendrait que le public ne se conduise ni comme les enfants ni comme les toxicomanes; qu’il ne réclame pas « tout » et « tout de suite », sans se sentir lui-même mobilisé. Il conviendrait surtout que le public n’entretienne pas l’illusion que la prévention des souffrances profondes de toute une génération pourra se faire « n’importe comment ».
Jean Bergeret, Les toxicomanes parmi les autres, éditions Odile Jacob, 1990