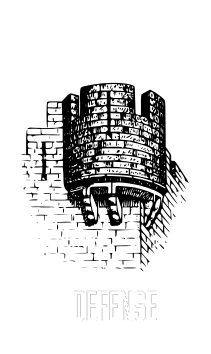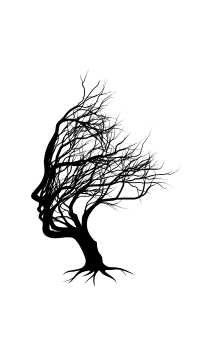Période de mutation biologique, psychique et sociale, l’adolescence est la dernière phase d’évolution de la personnalité permettant un réaménagement des structures profondes organisant la vie mentale d’un individu. C’est à l’adolescence qu’un psychotique peut encore se transformer en névrotique. L’adolescence est la période de toutes les crises et pour beaucoup d’entre-nous cette période charnière est difficile à vivre.
Un nouveau rapport au plaisir
L’apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté amorce une transformation décisive du corps et de l’esprit. L’adolescent développe ce que René Roussillon appelle « la capacité orgasmique », via des pratiques autoérotiques nouvelles, préliminaires à ce que deviendra plus tard une sexualité mature et adulte. Le sens du plaisir est bouleversé, il transite désormais par et pour l’autre. Ce que l’adolescent ne peut pas encore accomplir en acte, il le met en scène par son imaginaire : c’est le développement des fantasmes sexuels. On évoque souvent, jusqu’à en faire une sorte de fétiche psychique, la fameuse « crise » d’adolescence. Le fait est que tous les adolescents ne feront pas nécessairement de crises spectaculaires, les changements pouvant être plus doux et progressifs pour certains. Pour les autres, la conflictualité œdipienne resurgit et il s’agit de s’affranchir de la tutelle émotionnelle des parents pour se réaliser affectivement en dehors de la famille. Les amis deviennent plus importants à cet âge. Ils deviennent un point d’appui essentiel à la maturation psycho-affective et c’est à eux, et non plus aux parents, que l’adolescent se confie. « Adolescere », en latin, signifie « grandir » et cela devient un impératif. Contrairement aux périodes antérieur, le corps se développe à l’adolescence plus rapidement que les affects. L’adolescent n’a pas le choix, il est forcé par son corps de grandir, c’est-à-dire de s’adapter à une nouvelle configuration bio-psycho-sociale.
De l’autoérotisme à l’amour
L’adolescent explore son corps, se découvre dans sa jouissance, et se tourne davantage vers les autres. Le besoin d’intimité se développe. Les anciennes zones érogènes de la sexualité infantile sont à nouveau investies, dans un autoérotisme exacerbé, mais tourné résolument vers l’extérieur. Les premières relations amoureuses sont l’occasion d’expérimenter ce nouveau corps, pas vraiment adulte, mais plus tout à fait enfant. La sexualité devient un jeu où l’on jouit de l’autre autant que l’on jouit avec l’autre. On se donne et on se prend, de différentes façons. On se dénude, on s’expose. Nul doute que ce renouveau pulsionnel peut générer de l’anxiété : on trouvera ainsi, pas peur de l’exclusion, un excès de conformisme. L’adolescent est volontiers normopathe, il ressent comme un devoir d’apparaître « comme les autres », l’exclusion étant vécue comme un traumatisme. L’enjeu des premiers ébats sexuel est multiple : éviter la mécanique des corps imbriqués dans une sorte de gymnastique impersonnelle (comme la pornographie les met en scène), oser l’amour à deux dans la découverte du visage nu de l’autre, c’est-à-dire dans le respect mutuel, l’écoute, le jeu amoureux, et enfin parvenir à une satisfaction pulsionnelle qui épanouit plus qu’elle ne soulage. L’affaire n’est pas aisée, et la vie adulte prolongera la quête de jouissance avec l’autre, sous des formes moins expérimentales que les « premières fois ».
Le sens de la vie
Au-delà des enjeux psycho-affectifs, l’adolescence est aussi le moment des choix d’avenir. De nos jours, on observe une forte pression sociale sur les choix que l’adolescent doit faire pour ses études. À cet égard, il est probablement salutaire de rappeler qu’il faut du temps pour se connaître de telle sorte que les choix d’études soient les bons. L’impératif économique de réussite sociale ne doit pas nuire à l’épanouissement intellectuel de l’adolescent. Les études n’ont pas pour fonction unique de former à un métier, il s’agit aussi de développer un esprit critique et d’acquérir une culture personnelle. On devrait dire aux adolescents qu’ils ont droit à l’erreur, qu’ils ont le droit d’explorer, d’essayer, de revenir sur leurs choix, quitte à changer de cursus universitaire s’il le faut. Les parents, préoccupés par l’avenir économique de leurs enfants, négligent peut-être trop souvent cet aspect là. Or, d’un point de vue prophylactique, on pourrait éviter de nombreux burn-out professionnels si l’on autorisait des choix libres d’études pas forcément rentables dans l’immédiat. Ici, c’est la question du sens de l’existence qui se joue, et ce questionnement existentiel naît à l’adolescence et ne cesse jamais d’accompagner l’adulte tout au long de sa vie. L’adolescence, pour être heureuse, doit être vécue comme une chance, et non pas un fardeau. La psychothérapie peut justement aider à accompagner les difficultés affectives des adolescents et offrir un étayage relationnel précieux dans un moment charnière de la vie aux nombreux enjeux existentiels.
Référence bibliographique :
« L’adolescence et ses crises » in « Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale », René Roussillon et al., 2018, éditions Elsevier-Masson