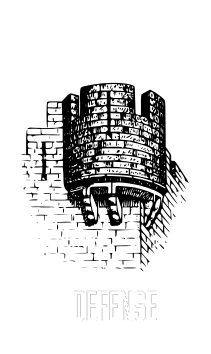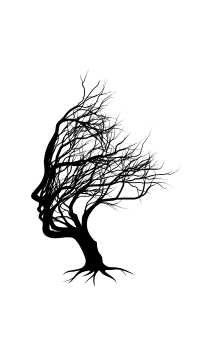Notre vie psychique n’est pas linéaire. Elle similaire à la surface d’un océan vaste et tourmenté, aux profondeurs insondables. Parmi les vagues qui affleurent sur les cotes du moi, il y a les pulsions. Concept phare de la psychanalyse, faisons le point sur nos connaissances sur les pulsions.
Définir les pulsions
Le terme de pulsion est apparu dans la langue française en 1625. C’est un dérivé du latin pulsio signifiant l’action de « pousser ». Employé par Sigmund Freud à partir de 1905 dans les Trois essais sur la théorie sexuelle, le concept devient très vite incontournable pour comprendre la dynamique de l’appareil psychique. Laplanche et Pontalis, dans leur Vocabulaire de la psychanalyse définissent les pulsions comme un « processus dynamique consistant dans une poussée (charge énergétique, facteur de motricité), qui fait tendre l’organisme vers un but. Selon Freud, une pulsion a sa source dans une excitation corporelle (état de tension) ; son but est de supprimer l’état de tension qui règne à la source pulsionnelle ; c’est dans l’objet ou grâce à lui que la pulsion peut atteindre son but. Dans Pulsions et destins des pulsions paru en 1915 dans la suite d’essais de la Métapsychologie, Sigmund Freud associe la pulsion à quatre caractéristiques : la poussée, le but, l’objet et la source.
Pour Freud, la poussée est « la somme de force ou la mesure d’exigence de travail que la pulsion représente« . A l’origine de la pulsion il y a une stimulation qui provoque du déplaisir et le but de la pulsion va être de mettre fin au déplaisir, ce qui génère du plaisir. Plusieurs voies peuvent conduire au même but et des buts intermédiaires peuvent apparaître sur le chemin de la satisfaction pulsionnelle. L’objet est le moyen « par lequel la pulsion peut atteindre son but« . L’objet peut être une autre personne ou notre propre corps. Freud ajoute : « Toute liaison particulièrement intime de la pulsion à l’objet se verra désignée comme fixation de ce dernier« . On comprend ici les fixations orales ou anales, selon la zone érogène d’où part la stimulation et où s’achève le désir. Quant à la source de la pulsion, Freud la définit comme un « processus somatique particulier dans un organe ou une partie du corps« .
Destins des pulsions
Freud (1915) distingue quatre destins (devenirs), des pulsions :
- Le renversement en son contraire. Une pulsion peut se retourner de l’activité vers la passivité ou opérer un renversement quant au contenu. Exemples : la paire sadisme-masochisme, voyeurisme-exhibitionnisme, amour-haine.
- Le retournement contre la personne propre. Freud illustre ce destin particulier de la pulsion par l’exemple du masochisme, compris comme un sadisme retourné contre le moi. De la même manière, l’exhibition implique la contemplation de son propre corps. Du point de vue psychanalytique, il ne fait pas de doute que le masochiste partage la jouissance des sévices que le sadique lui inflige, comme l’exhibitionniste jouit de sa propre mise à nu.
- Le refoulement. Pour Laplanche et Pontalis, le refoulement est « une opération par laquelle le sujet cherche à maintenir dans l’inconscient des représentations (pensées, images, souvenirs) liées à une pulsion. Le refoulement se produit dans les cas où la satisfaction d’une pulsion – susceptible de procurer par elle-même du plaisir – risquerait de provoquer du déplaisir à l’égard d’autres exigences. »
- La sublimation. Il s’agit d’activités sans rapport à la sexualité, valorisées socialement, et investie d’une forte charge libidinale. Les activités artistiques, scientifiques, le travail de l’intellect, sont autant d’exemples de la sublimation. On doit sans doute nos plus grandes réalisations artistiques et découvertes scientifiques à la sublimation.
Développements et discussion
D’après Freud une pulsion est une force constante qui prend sa source à l’intérieur de l’organisme. On peut parler de stimulus pulsionnel qui crée un « besoin » qui doit être satisfait. La marque distinctive de la pulsion est l’impossibilité de la contraindre par une action de fuite comme on peut le faire avec des stimulus externes à l’organisme. La stimulation à l’origine de la pulsion est inévitable et continue. Le stimulus à l’origine de la pulsion crée du déplaisir, sa satisfaction mettant fin au stimulus crée du plaisir. Le plaisir signifie donc une diminution de la stimulation. Freud parle de « concept frontière entre psychique et somatique ».
Certaines pulsions sont « inhibées quant au but » c’est-à-dire qu’elles consistent, nous dit Freud, en des « processus qui auront la liberté de parcourir un bout de chemin en direction de la satisfaction pulsionnelle, mais qui subiront alors une inhibition ou un détournement. » Pour Lacan, la pulsion est un montage caractérisé par une discontinuité et une absence de logique rationnelle au moyen duquel la sexualité participe de la vie psychique en se conformant à la « béance » de l’inconscient. Lacan développe en fait l’idée que la pulsion est toujours partielle. Le terme est ici à entendre en un sens plus général que celui retenu par Freud. En adoptant le terme d’objet partiel, issu de Karl Abraham et des kleiniens, il introduit deux nouveaux objets pulsionnels : la voix et le regard. Il les nomme : « objets du désir. »
Typologie des pulsions
Freud s’opposait à l’idée de catégoriser les pulsions de manière trop détaillée, l’énergie libidinale étant la même dans toutes les pulsions, qui peuvent changer d’objet et de source, mais pas de nature (les pulsions sont toujours sexuelles). Cependant, Freud déploie une conception dualiste des pulsions. Il distingue ainsi les pulsions d’autoconservation et les pulsions sexuelles. Plus tardivement, il reformule ce dualisme et distingue les pulsions de vie et les pulsions de mort. Il parle également de « pulsion du moi » et de « pulsion partielle ».
La pulsion doit être « représentée » dans la psyché. Elle produit des « représentants-psychiques » qui sont les formes par lesquelles nous pouvons connaître la pulsion. Freud dit aussi que la pulsion est la « mythologie » des psychanalystes ; c’est un concept, pas une chose, c’est une proposition « théorique » qui postule l’existence d’un être psychique qui n’est pas directement connaissable, si ce n’est par l’intermédiaire de ses « représentants-psychiques ». Ceux-ci sont au nombre de trois :
- le représentant-affect, qui regroupe toutes les formes de ce qui affecte la psyché : sensation, émotion, passion, sentiment, humeur ;
- le représentant-représentation de choses, dont les images qui composent le rêve sont l’exemple majeur ;
- le représentant-représentation de mots, qui correspond à l’appareil du langage.
On le voit, la question des pulsions a été développée en profondeur par la psychanalyse, si bien que le concept est devenu central. On ne saurait adopter de perspective analytique sans disposer d’une bonne compréhension des pulsions et de leurs fonctions dans l’appareil psychique.
Bibliographie :
Sigmund Freud :
- Trois essais sur la théorie sexuelle, 1905.
- Pulsions et destins des pulsions, in Métapsychologie, 1915.
- Au-delà du principe de plaisir, 1920
Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, éditions Elsevier Masson, 2018 : Chapitre 3 « La pulsion et ses sources »
Vocabulaire de la psychanalyse, J. Laplanche et J-B Pontalis, Presses Universitaires de France, 1967, page 359
Dictionnaire de la psychanalyse, E. Roudinesco et M. Plon, éditions Fayard, 2023, page 864