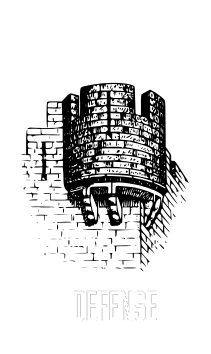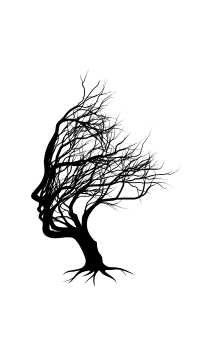En 1900, Sigmund Freud (1856-1939) fait paraître l’ouvrage fondateur de la psychanalyse : L’interprétation du rêve. C’est dans ce travail monumental, de plusieurs centaines de pages, que le neurologue viennois étudie les rêves, leur formation et leur signification. Voici une brève synthèse de la théorie freudienne du rêve.

Pour Freud, le rêve n’est pas un phénomène physiologique dénué de sens : bien au contraire, les images qui se succèdent dans les songes peuvent être interprétées. Durant le sommeil, la vigilance du dormeur est moindre que durant l’état de veille. Cette perméabilité de l’esprit rend possible l’infiltration en direction de la conscience de désirs et pulsions inconscientes. Afin que la manifestation de ces désirs d’ordinaire inconscients ne nous réveillent pas, le rêve va les déformer, les dissimuler grâce à un symbolisme propre à chaque rêveur. C’est en ce sens que l’on peut qualifier le rêve de « gardien du sommeil« . Le rêve est étrange, bizarre, surprenant justement parce qu’il travaille à nous dissimuler nos motions pulsionnelles les plus intimes.
Freud distingue ainsi deux dimensions du rêve : le contenu manifeste (ce que l’on voit dans le rêve) et le contenu latent (ce que le rêve signifie vraiment). Le contenu latent, ou les pensées du rêve, est produit par deux mécanismes : la condensation et le déplacement. La condensation permet à une image onirique de représenter plusieurs désirs inconscients, lesquels sont compressés dans une seule image. Le déplacement modifie l’inconscient en lui substituant des images connexes, apparemment dénuées de sens. Condensation et déplacement travaillent de concert à la formation du rêve. Si le rêve nous dissimule nos plus intimes désirs alors que notre degré de vigilance est amoindri par le sommeil, c’est par l’effet de ce que Freud appelle la censure. L’analyse de rêve d’enfant permet de se faire une bonne idée des fonctions du rêve. Moins concerné par le refoulement qu’un adulte, l’enfant voit dans ses rêve l’accomplissement de désirs issus de la journée précédente.
Freud distingue trois types de rêves : les rêves représentant un désir non voilé et non refoulé, les rêves qui expriment un désir refoulé (la majorité de nos rêves) et les rêves qui représentent un désir insuffisamment refoulé. Dans ce dernier cas, le sentiment de peur, d’angoisse, accompagne souvent le rêve, qui peut échouer dans sa fonction de gardien du sommeil, pouvant ainsi nous réveiller. C’est le cas des cauchemars.
Pour analyser nos rêves, on procédera par la technique de la libre-association : on laisse, pour chaque image, venir à nous les idées afférentes, jusqu’à ce que le sens du rêve apparaisse. Cela nous rappelle la règle fondamentale de la psychanalyse : le patient doit, pendant chaque séance, laisser jouer les associations d’idées, en exprimant tout ce qui lui vient à l’esprit, même s’il s’agit d’idées désagréables ou pénibles. L’interprétation des rêves devient l’un des piliers de toute pratique psychanalytique.
Depuis Freud, le phénomène du rêve a donné lieu à bien d’autres travaux, de disciplines diverses et variées. On peut désormais étudier la sociologie du rêve (Bernard Lahire), faire une ethnologie comparée des rêves, ou même s’en servir comme source d’inspiration artistique. Parmi les mouvements artistiques qui ont puisé leurs inspirations dans le rêve, on citera le romantisme et le surréalisme. Nul doute que nous n’avons pas épuisé le sujet du rêve et que de nombreuses découvertes restent à faire, notamment en matière de neurosciences. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit, et un bon voyage au pays des rêves !